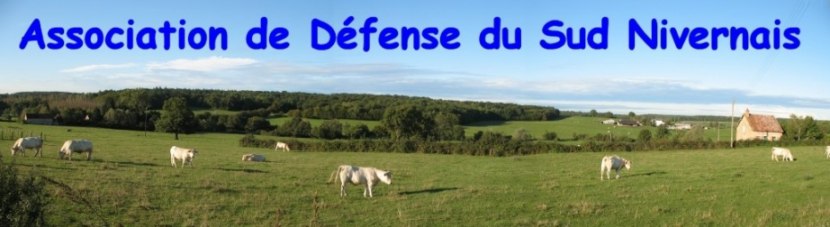
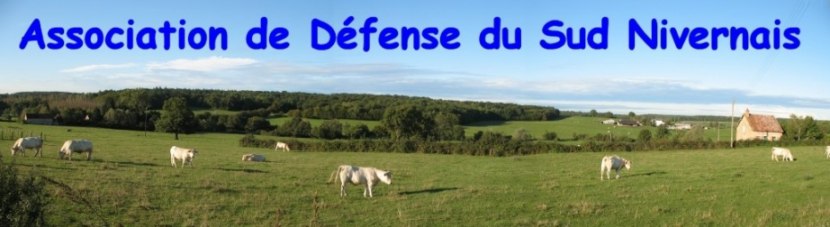
|
Mercredi 1er décembre 2015 L'amende de 20 000 $ confirmée pour la société Link Energy en Alaska. Celle-ci avait procédé à des forages dans la perspective de gazéification souterraine du charbon (processus de transformation souterraine du charbon en gaz pour la production d'électricité) Cette technique était celle envisagée sur notre territoire...
Mercredi 8 juillet 2015 La société Link Energy est condamnée à une amende en Alaska, pour ne pas avoir fourni d'informations relatives à trois puits autorisés (près de la communauté de Tyonek) pour la gazéification du charbon (nombreuses violations de la règlementation). Link Energy a jusqu'au 1er Août pour fournir les informations. Plus d'informations Et dire que nos élus nivernais étaient prêts à les accueillir pour saccager notre belle région...
Mercredi 10 juin 2015 Australie : Le gouvernement australien du Queensland élargit son action en justice contra la société Link Energy Une cinquième action en justice a été déposée ce jour concernant des dommages graves et irréversibles à l'environnement
Jeudi 29 Mai 2014 Australie : Le procès de la société Linc Energy a été ajourné au tribunal de première instance de Chinchilla jusqu'au 23 Juillet. A la rubrique "Les Projets", vous pourrez découvrir une nouvelle rubrique : le Projet Linc Energy et très bientôt également les remarques sur les impacts causés par la gazéification souterraine.
Jeudi 15 Mai 2014 De l'Or sous nos pieds Le 12 Août 2006, les habitants du Sud Nivernais s'en souviennent : le Journal du Centre titrait leur une "Une mine de charbon et une centrale thermique dans le sud de la Nièvre". Le ciel nous tombait sur la tête. Après bien des batailles, le 14 décembre 2009, Jean-Louis Borloo alors ministre de l'Écologie, de l'Énergie, du Développement Durable et de l'Aménagement du Territoire mettait fin à notre attente et refusait les demandes présentées. Depuis ce jour, même si personne n'avait oublié que le charbon était sous nos pieds, le charbon est devenu moins présent dans nos esprits et la vie a repris dans nos communes. Le 15 mai dernier, la une du Journal du Centre "De l'or sous nos pieds" a semé la consternation dans nos villages. "Pas vrai, ça recommence" Comme en 2006, les habitants et les élus locaux ont découvert la nouvelle par l'intermédiaire du journal. Une société australienne, Linc Energy, a déposé une demande en 2013 auprès du Ministère du Redressement Productif. Elle souhaite implanter une unité de gazéification souterraine du charbon "Cette technique, écologiquement sûre et sans impact sur les paysages, permettrait de créer 1000 emplois lors de la construction puis 500 emplois permanents." Cela ne vous rappelle rien ? En 2006, on nous promettait 1000 emplois lors de la construction puis 800 emplois. (400 créés et autant induits) ! L'ADSN est là pour continuer le combat. Pour mieux connaître la gazéification souterraine du charbon
Lundi 31 Janvier 2011 GAZ
DE SCHISTE, GAZ DE HOUILLE Les gaz de schiste sont une forme de gaz naturel appelé «non conventionnel» en raison des techniques d'exploration et d'exploitation qui diffèrent de celle du gaz «conventionnel». L'usage des gaz de schiste comme combustible est le même que celui du gaz naturel. Le Gouvernement a accordé courant 2010 des PER (Permis Exclusif de Recherches) concernant le gaz de schiste en Languedoc Roussillon, dans le Tarn et de nombreuses demandes ont été déposées concernant les grands bassins alluviaux aquitain, parisien et rhodanien. L'éventualité de l'exploitation du gaz de charbon au niveau du gisement de Lucenay-Cossaye ne bénéficie pas du même retentissement médiatique, mais son mode d'extraction comporte les mêmes conséquences environnementales majeures, avec en prime le risque incontrôlable de l'auto-combustion du charbon. Les nuisances dues à l'exploitation du gaz de schiste sont aussi catastrophiques que les nuisances dues à l'exploitation du gaz de houille. Pour avoir plus d'information sur le gaz de schiste et ses nuisances
Des pétitions contre ces exploitations sont actuellement en ligne : http://www.petitions24.net/signatures/gaz_de_schiste__non_merci http://www.lapetition.be/en-ligne/contre-l-exploitation-du-gaz-de-schiste-8997.html
Samedi 1er janvier 2011 Le Conseil d'administration de l'ADSN vous présente à vous et à vos proches ses meilleurs voeux pour l'année 2011.
Vendredi 29 octobre 2010 L'assemblée générale de l'ADSN s'est déroulée cette année à Cossaye devant une assistance nombreuse. Après le discours de bienvenue du président, les points suivants ont été abordés :
A l'issue de cette assemblée, un pot d'amitié à été offert.
Dimanche 17 octobre 2010 Au nom du Conseil d'Administration, M. Christophe PELLETIER, Président de l'ADSN, est heureux de vous convier à l'assemblée générale de l'ADSN le vendredi 29 octobre 2010 à 18 heures dans la salle polyvalente de Cossaye. Adhérents à l'ADSN, vous devez avoir reçu une invitation écrite. Si vous ne pouvez pas participer à cette assemblée, votre pouvoir nous est cependant indispensable. Celui-ci doit nous être retourné (ADSN - BP8 - 58380 LUCENAY-LES-AIX) avant le 23 octobre 2010 ou donné à la personne de votre choix qui vous représentera. Venez nombreux.
Samedi 21 Août 2010 Dissolution en cours de La SEREN Aux termes d'une délibération en date du 16 juin 2010, l'assemblée générale extraordinaire des actionnaires de la SEREN a décidé la dissolution anticipée de la société à compter du même jour et sa mise en liquidation amiable. Le procès-verbal a été déposé au greffe du tribunal de commerce le 10 août 2010.
Nouveau look pour le site de l'ADSN et plein de nouvelles rubriques. Bonne lecture à tous...
Samedi 02 janvier 2010 Les membres du bureau de l'ADSN, son président M. Christophe PELLETIER et les webmasters présentent à tous les adhérents de l'association et à tous les visiteurs du site leurs meilleurs voeux pour la nouvelle année. Pour les partisans du "NON AU CHARBON" celle-ci commence sous les meilleures auspices puisque le Ministre Jean-Louis BORLOO leur a donné gain de cause en fin d'année. Mais nous ne devons pas nous reposer sur nos lauriers car VALORCA n'a pas dit son dernier mot. Avec son permis de recherche pour extraire le méthane, VALORCA essaie de contourner la difficulté. On est en droit de penser que, si VALORCA pouvait extraire le méthane du sous-sol, il ne s'arrêterait pas en si bon chemin, il en profiterait pour demander une nouvelle concession d'exploitation du charbon, celui-ci étant alors débarrassé de son grisou. Enfin, extraire le méthane est extrêmement polluant ; il faut pomper et rejeter des millions de litres d'eau très polluée et très néfaste pour l'environnement. Nous reportons donc maintenant tous nos efforts sur ce dernier projet de VALORCA et nous vous tenons au courant. |
||
Vendredi 17 décembre VICTOIRE ! ! ! Le Ministre Jean-Louis BORLOO refuse les deux concessions ! Par une lettre envoyée le 14/12/2009 aux maires des communes concernées, le Ministre de l'écologie, de l'énergie, du développement durable et de la mer, M. Jean-Louis BORLOO a rendu son verdict : Il ne donne pas une suite favorable aux demandes de concessions présentées. |
||
Dimanche 1er novembre Ce dernier jeudi, 29 octobre 2009, avait lieu la réunion du nouveau Conseil d'Administration de l'ADSN. A l'ordre du jour, élection du nouveau bureau. Pour voir les nouveaux responsables, cliquez sur le lien ci-contre Qui sommes-nous ? ou dans le tableau des liens ci-dessus. |
||
Vendredi 16 octobre, comme prévu, s'est déroulée l'Assemblée Générale de l'ADSN à partir de 18 heures. Les adhérents sont venus nombreux (132 personnes) ; 184 personnes avaient donné leur pouvoir. A l'ordre du jour : La soirée s'est terminée par un pot de l'amitié. Merci à tous les adhérents. |
||
Vendredi 09 octobre 2009 Au nom du Conseil d'Administration, M. Christophe PELLETIER, Président de l'ADSN, est heureux de vous convier à l'assemblée générale le vendredi 16 octobre 2009 à 18 heures. Adhérents à l'ADSN, vous devez avoir reçu une invitation écrite. Si vous ne pouvez pas participer à cette assemblée, votre pouvoir nous est cependant indispensable. Celui-ci doit nous être retourné (ADSN - BP8 - 58380 LUCENAY-LES-AIX) avant le 10 octobre 2009 ou donné à la personne de votre choix qui vous représentera. |
||
Voici ce que VALORCA nous réserve avec son projet d'exploitation du méthane de houille. Un article paru aux USA sous le titre : " Coal Bed Methane - An Inside Look ". (Montana Environmental Information Center:Street Address : 107 W Lawrence St. #N-10, Helena, MT 59601 par Amy Frykman, brosse un tableau assez réaliste des conséquences d'une telle exploitation. Voir le lien ci dessous Northern Plains Resource Council Ce document a été traduit par l'un d'entre nous ; pour lire cette traduction... |
||
Le 13 juillet 2009, LE PARLEMENT EUROPÉEN a établi un programme d'aide à la relance économique par l'octroi d'une assistance financière communautaire à des projets dans le domaine de l'énergie. Lien vers le site : http://eur-lex.europa.eu/LexUriServ/LexUriServ.do?uri=OJ:L:2009:200:0031:0045:FR:PDF Si plusieurs propositions relatives à des projets situés dans le même État membre remplissent les critères d'éligibilité, la Commission retient au maximum une proposition par État membre parmi ces propositions.
La déduction est simple en ce qui concerne le projet de mine de LUCENAY/COSSAYE. |
||
Lors de leur dernier Conseil municipal respectif, les élus de COSSAYE et LUCENAY LES AIX, après en avoir délibéré, (à l'unanimité pour COSSAYE) donnent mandat à leur maire pour engager tous les recours administratifs et juridictionnels de nature à s'opposer à la délivrance d'un titre minier ou à la réalisation d'opérations de recherches ou d'exploitation minière sur le territoire communal. |
||
La société Valorca a déposé en janvier 2009 une demande de Permis Exclusif de recherches (PER) concernant le méthane présent dans les couches de charbon.
|
||
|
Copyright ADSN 2010 |
||
|
Vous êtes le Site optimisé pour Mozilla Firefox |
||